Analyse - Inégalités et violences de genre
Avril 2023 | Par Isabelle Seret et Xavier Briké
Isabelle Seret est intervenante en sociologie clinique et formée à la victimologie appliquée. Elle accompagne des personnes victimes et des auteur·es de violences intrafamiliales. Nous la rencontrons dans le cadre d’une démarche initiée à Placet-UCLouvain autour des violences de genre[1] et en vue de son intervention dans le cadre de la formation (Certificat d’Université) que nous lancerons en septembre 2023.
Un contexte
En 2018, une association du Calaisi contacte Isabelle Seret pour mettre en place une prise en charge des auteur·es de violences intra familiales : « Je n’ai pas à me poser la question de leur responsabilité ou pas. Les faits sont avérés. La justice a tranché ».
À raison de trois heures tous les quinze jours, Isabelle permettra à l’auteur de se réapproprier la demande de changement et la responsabilité de ses actes violents. Il travaillera la perception des croyances qui entretiennent le recours à la violence. De fait, reconnaitre que leurs actes sont répréhensibles, apprendre à déceler les émotions et les signes qui les conduisent à être violent·es. (écoute de soi émotionnelle), trouver des alternatives à la violence (élaborer) et faire l’expérience du partage apparait essentiel .
L’initiative est à souligner. Il ne s’agit plus de mettre à l’abri le conjoint victime et les enfants mais bien d’extraire le conjoint violent et de le « soumettre » à une mise au travail. Isabelle permet à ces hommes de dévoiler peu à peu leur vécu, les certitudes qui les animent. Ils expriment leurs failles, leur besoin de dominer et de punir, des amitiés qu'ils développent dans leur foyer spécialisé.
Une méthodologie
Ces dispositifs sont généralement appelés « groupe de responsabilisation ». Ils ont en effet pour particularité d’offrir des modules pré-construits et un enseignement de type vertical. En tant qu’intervenante en sociologie clinique, je souhaitais que les participants se réapproprient la demande de changement. Mais travailler au départ de la subjectivité des auteurs devenus sujets du dispositif demande de tenir une posture bienveillante, sans jugement, ouverte à la subjectivité des participants et nécessite un dosage délicat d’empathie pour favoriser les dires sans pour autant les accepter. Cette tension à la fois externe - un cadre à tenir - et interne - accepter mes ressentis - a généré une vigilance colossale. « Ma femme n’aime pas la moto mais je la force à monter quand même. Elle n’aime pas pour son brushing. Elle aime son confort ». Outre le déni qui les caractérise, ces propos reflètent des stéréotypes de genre qu’il n’est pas forcément simple de mettre au travail car ils sont complètement intériorisés.
L’asbl Praxis stipule que « ce type d’accompagnement demande à l’intervenant une grande capacité de contrôle étant donné les réactions que ces scènes peuvent susciter chez lui. Ses réponses peuvent être en lien avec l’intensité de la violence décrite, mais également avec la reconstruction cognitive utilisée par l’auteur pour justifier ses agirs violents »[2].
Lors de la première rencontre, Patrick parait très tendu. Il ne côtoie plus le monde du travail depuis plus d’une dizaine d’années, comme la majorité des autres participants. Il vit mal, très mal, cette disqualification sociale ainsi que l’ordonnance du juge qui lui impose une mesure d’éloignement du domicile familial.
Moi ma vie s’est arrêtée ce jour-là. J’étais vexé le jour où je suis sorti du tribunal. J’étais avec mon sachet en plastique avec quelques habits dedans et il y en a un, du Samu social, qui m’a demandé si j’étais à la rue. J’ai dit « non Monsieur » assez fermement pour qu’il garde ses distances. Il m’a quand même donné un café.
Cette scène dit la honte qui le ronge. L’alcool dilue leur mal-être. Les drogues aussi. Pourtant ils ne sont pas dupes car, si ces substances leur permettent de supporter leur invalidation sociale, elles les éloigne de tout espoir de reconstruire une vie où l’argent du travail nourrirait la famille, où le père serait un socle sur lequel s’appuyer. Mais peut-être que cette image de la masculinité n’est réelle que dans leur rêve, peut-être ont-ils depuis longtemps vécu la disqualification. La réussite de leurs parents et l’ascension sociale qui leur était promise est souvent un leurre, ouvriers peu qualifiés ils sont restés.
Cette disqualification est aussi intime. Bell Hooks [3] « Jouer son rôle de garçon est une chose différente du simple fait d’être ce qu’on est. La culture patriarcale ne permet pas aux hommes d’être simplement qui ils sont, ils doivent faire preuve de caractère, d’affirmation de soi, de virilité et d’utilité ».
Partick, quand son épouse le mettait à la porte, avait toujours à portée de main la clé du garage. Il se glissait à l’arrière de la voiture où l’attendait dans le coffre la couverture habituelle. Jonas écoute et répond :
– T’as qu’à acheter une serrure avec verrou intérieur. Y’a pas de clé. On ne sait pas fermer de l’intérieur. Comme ça si elle ferme, bah, tu ouvres quand même.
– Comment avez-vous eu l’idée ?
– Oh ben j’l’ai pas eue. J’ai vu mon père faire et mon grand-père faire.
Des mécanismes à déconstruire
Ainsi la pratique de la violence et ses stratégies se transmettent comme une recette de cuisine, comme des chaussettes à repriser, des ampoules à remplacer. Sans crier gare, des uns aux autres, un malicieux copiage s’opère sans s’interroger sur le sens, se consulter sur les raisons. Il y aurait comme une forme d’habituation, faute d’avoir appris d’autres modes de communication, à la relation conflictuelle. « Les gifles ou les fessées qu'on reçoit de ses parents pour nous apprendre à écouter les adultes et en réaction à une bêtise qu'on a faite nous font intérioriser dès l'enfance la justification de la violence [4]». Dans ce groupe, Jonas prend conscience grâce aux récits de ses pairs qu’il est le produit d’une histoire, qui n’est pas pour autant une simple répétition.
Au fil des séances, Patrick libère une parole soucieuse : « On n’a pas demandé à le devenir. Faut voir les conditions dans lesquelles on l’est devenu. Avec le mot auteur, on nous considère juste comme ça mais avant d’être auteur, on était quoi ? On était une personne. On a des doutes sur nous ». Un autre dira : « Je préfère acteur, car j’ai agis. J’ai posé un acte. Je suis acteur de violence ».
La prise en charge des violences intra familiales est finalement assez récente : « là où l’évocation de la famille était auparavant synonyme d’intimité et donc de « laisser faire », elle est désormais synonyme de lieu de risque, susceptible de fonder l’intervention publique »[5]. On doit particulièrement aux mouvements féministes à partir des années 1970 et milieux associatifs le fait d’avoir extrait la problématique d’un intime clos pour mettre au grand jour un fait de société. Une des conséquences de cette origine est notamment une lecture militante de la situation où on ne peut que constater la quasi-absence des hommes, parfois pères, dans les discours y compris politiques. À écouter les propos des auteurs à ce sujet, cela pose quelques questions :
- Quel est le sens d’une démarche de conscientisation et de désappropriation de la violence des auteur·es de violences quand l’espace public ne cesse de cliver le genre ?
- Les mouvements féministes tels #MeToo, #Balancetonporc clivent-ils la société au risque de renforcer les violences liées au genre ?
Il m’apparaît crucial de réfléchir sur une manière de prendre en compte et en charge les auteur·es de violences sur leur double fonction conjugale et parentale. Apprendre à s’exprimer leur permet de dire au lieu d’agir. Ce projet a porté, aussi subtils soient-ils, quelques fruits et vise à briser ce qui est couramment nommé violences systémiques. « Les auteur·es de délits ne sont plus considéré·es comme des personnes déviantes individuellement, mais comme les produits d'une destruction de leur tissu social qui les a mené·es vers la délinquance. Ainsi, les délits commis ne sont plus envisagés comme des fautes morales qui méritent d'être punies, mais comme les fruits d'un système qui doit être réparé en profondeur[6]».
L’importance du dispositif
Pour Isabelle Seret, se confronter à la violence nécessite forcément de travailler son contre- transfert. Elle l’a fait par le biais de l’écriture. « Chez moi vit la violence » décrit tout à la fois la méthodologie, les supports utilisés et ce que ce travail lui a permis de mettre à jour. S’il est certain que les mouvements féministes se sont battus pour que soient pris en considération au niveau pénal les faits de viol, d’inceste, de harcèlement, etc., la demande va souvent vers plus de pénalisation. « Or, la prison est le lieu même où les hommes sont contraints d’exercer leur masculinité et de s’afficher dominant, et ce juste pour résister à ce milieu, tenter d’y trouver place. Lieu de virilité, d’imposition de soi, il m’apparait être le dernier endroit où les caserner. »
L’intervenante en sociologie clinique souligne l'importance d'être sujets du dispositif. Il est essentiel, selon elle, de ne pas réduire l’analyse à ce qui se joue au sein d’une relation entre deux personnes, au risque de nier la part du social en chaque individu : les socialisations, les normes de genre, le contexte socio-politique et législatif incluant des réponses variables aux actes de violence, la situation socio-économique impactant la vie quotidienne (exiguïté du logement, horaires de travail, etc.). Dans la lignée de l’anthropologue Pascale Jamoulle[7] (2021), elle évite de parler de « relations d’emprise ». Son enquête révélée au travers de l’ouvrage « Je n’existais plus » aborde les mondes de l’emprise et de la déprise comme « une machinerie, un système, qui n’est pas seulement le fait d’une personne ou d’un dispositif abuseur, ni de la fragilité d’une victime. L’emprise ne se limiterait pas non plus à la relation qu’ils nouent, elle se love là où elle trouve une niche écologique ». Plutôt qu'une forme de comportement déviant assigné à un genre, nos sociétés devraient peut-être s'interroger sur les formes de masculinités qu'elles valorisent et desquelles des rapports de genre et de sexes fondamentalement problématiques résultent. Selon la psychologue Inès Gauthier[8], presque nonante-cinq pourcent des auteurs d'agressions sexuelles (incestes) pris en charge ne récidiveraient pas, ce n’est dès lors plus seulement « un rappel à l’ordre des coupables qui se faisait entrevoir là, mais un véritable travail de prévention pouvant s’effectuer en amont » afin d’éviter le pire. 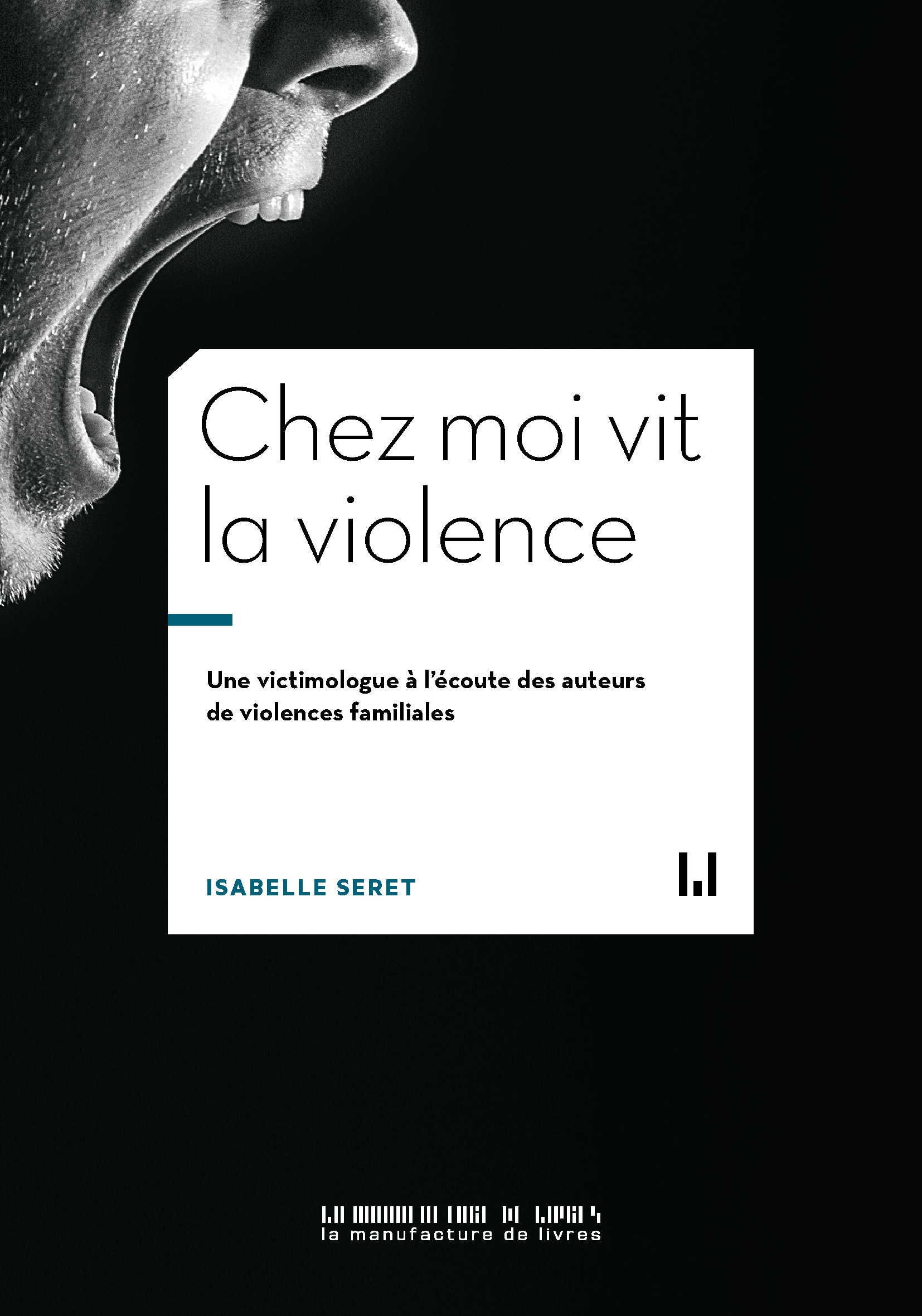
Télécharger la publication en format PDF
[1] Selon le Collectif contre les Violences familiales et l'Exclusion (CVFE), la violence conjugale est une violence de genre car «partout dans le monde, les femmes représentent l'immense majorité des victimes des violences conjugales».
[2] Kowal C.; Roussel M.; Deroe E.; Gobert V., (Éd), 2016, Violences conjugales et famille, Malakoff, Dunod éditions.
[3] Hooks B., 2021, La volonté de changer. Les hommes, la masculinité et l’amour, Paris, Éditions Divergences
[4] Dussy D., 2021, Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste, Pocket éditions.
[5] Séverac N, (Éd), 2021, L’enfant face à la violence dans le couple, Malakoff, Dunod.
[6] Bastide L., 2022, Futur.es. Comment le féminisme peut sauver le monde, Paris, Allary éditions.
[7] Jamoulle P., 2021, Je n’existais plus. Les mondes de l’emprise et de la déprise, Paris, Éditions La Découverte.
[8] Clavier B., Gauthier i., 2021, L’inceste ne fait pas de bruit. Des violences sexuelles et des moyens d’en guérir, Paris, Éditons Payot.










